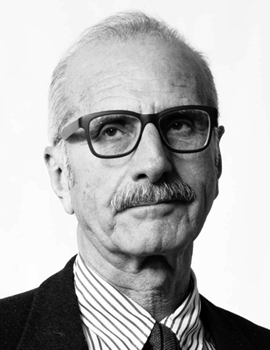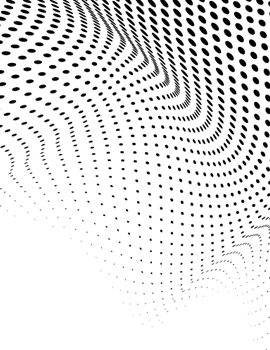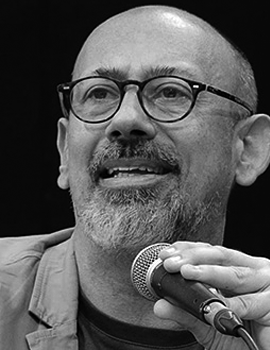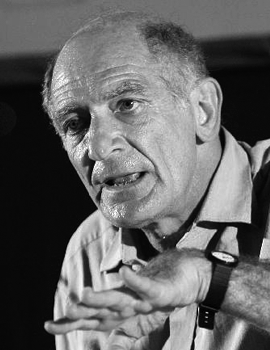Nostalgie du père
(French version)
1
Vatersehnsucht : Freud désigne ainsi[1]le rapport premier – originaire, archaïque au sens le plus propre – que toute constitution d’identité (d’un individu, d’un moi) implique nécessairement. Par rapport à cette nostalgie irreprésentable nous ne connaissons que des substituts : Idéal du moi, Dieu, Chef, et aussi «père» à tous les sens du mot.
Or Freud sait comme nous tous que la nostalgie est tendue vers un inaccessible, voire un impossible. Le mot français (en fait grec) évoque la douleur de ne pouvoir pas faire retour. Le mot allemand désigne une tension obsédante vouée à rester tendue. Avec cette expression tout est dit : le Père n’a pas eu lieu. Il n’a pas lieu d’être même si son rôle ou sa figure sont nécessaires. Si Freud ne l’énonce jamais ainsi il est souvent très près de le suggérer. Si le Père n’existe pas, toute constitution de foule organisée selon une hiérarchie au sens le plus fort du mot (une sacralité archaïque) repose sur une substitution factice. Par principe, la société s’ordonne à une suppléance[2]de son propre principe. Ce qui peut aussi se dire ainsi : elle est an-archique de manière essentielle.[3]
Si la société est anarchique et si en somme la dispersion ou la dissociation la guette ou la hante toujours, il faut bien se demander comment est possible la moindre association. Freud a abordé ce problème dans Psychologie des masses et analyse du moi, dans Totem et tabou, Malaise dans la civilisation, Moïse et le monothéisme ainsi que de manière plus occasionnelle dans d’autres textes. C’est une de ses préoccupations majeures à partir de 1921 (date du premier de ces livres).
Dans le titre Psychologie des masses et analyse du moi il faut être attentif à la conjonction de coordination. Elle n’annonce pas une simple coordination mais bel et bien une implication réciproque. La question des masses doit passer par celle du moi qui pour sa part n’est pas dissociable de la première. Il faut de plus pressentir un chiasme : la psychologie serait plutôt attendue au sujet du moi tandis qu’à propos des masses elle peut paraître une gageure. Quant à l’analyse du moi – c’est-à-dire à sa psychanalyse – elle devra prendre en compte la masse. Comment chacun des deux termes est-il engagé par l’autre, c’est tout l’enjeu du livre. Il ne s’agit de rien d’autre que d’examiner comment masse et moi, qui de prime abord s’opposent voire s’excluent, se composent au contraire voire s’incluent.
La nostalgie du Père – son inanité autant que sa ténacité – sera pour finir ce qui commande ce double et interminable mouvement dont la Mère, en revanche, apparaîtra comme l’espace où il se déploie.
2
La masse[4](ou les masses) telle que Freud la reprend à Le Bon se distingue chez celui-ci de la « race » ou du « peuple ». Ce dernier procède d’une hérédité et d’un héritage ; il se manifeste dans une civilisation ou dans une culture, donc par des mœurs, des traditions, etc. La foule ou la masse au contraire est un assemblement non hérité mais suscité par une situation ou par une organisation distincte du « peuple » même si elle se trouve en lui (ainsi l’armée ou l’Eglise). La masse ne se reçoit pas d’une origine propre, elle se forme de manière spontanée ou arbitraire mais elle n’est pas « indigène » au premier sens du mot.
Cette distinction engage tout le problème : comment se forme un groupe sans héritage ni identité donnés ? C’est-à-dire comment se forme le premier groupe humain ? Freud sera conduit par la suite à étudier les sociétés totémiques car il y trouvera des signes de la formation d’un peuple à partir de ce qu’il aura établi comme un rapport premier à une origine dérobée. Un totem est toujours un ancêtre : il désigne ou il figure celui-ci. Une masse ne sait pas ou ne peut pas désigner ni figurer son ancêtre.
Ou bien, et plus exactement, une masse est ce dont la formation est contemporaine ou cooriginaire à la figuration même d’une origine ancestrale. C’est vers cette cooriginarité que Freud progresse dans Massenpsychologie.
Ce faisant, il affronte la question de la formation des individus qui composent la masse. Très précisément, il s’agit de comprendre comment ils peuvent composer entre eux. Freud ne cesse pas de se débattre avec la difficulté de cette composition. Considérée du point de vue de l’individu ou du moi elle est exclue si le moi se caractérise par son autosuffisance. Considérée du point de vue e la masse elle est opaque si la masse coagule en quelque sorte des unités sans traits distinctifs. La masse en effet met en évidence toutes sortes d’effacements des autonomies individuelles.
Freud renouvelle en somme la question de ce que Kant nommait l’insociable sociabilité. Schopenhauer l’a illustré par la fable des porc-épics citée dans Massenpsychologie(VI).[5]Ce n’est rien moins que la question autour de laquelle ont tourné toutes les pensées socio-politiques des Modernes : comment est-il possible de faire société ?
3
En termes freudiens et en recourant au livre publié deux ans plus tard – Le moi et le ça – on peut dire que la question devient celle de savoir comment un moi se détache du ça et comment une fois détaché il peut rencontrer un autre moi. Ainsi formulée, la question se complique. Elle ne procède pas seulement de l’a priori d’un individu autonome mais en même temps elle questionne la provenance de cet individu et donc son autonomie.
A travers tous les textes déjà mentionnés Freud s’emploie à relativiser ou à réduire cette autonomie. Le moi n’est jamais complétement séparé du ça (tout comme le conscient de l’inconscient). Il n’en est après tout qu’une « surface ». Il y a plusieurs moi mais ils communiquent tous avec un ça qui semble lui-même tout autant celui de chacun que le même pour tous. La question cruciale de Massenpsychologie est celle de ce que Freud nomme les identifications, c’est-à-dire les possibilités de communication (de contagion, de rapport hypnotique) qui ne relèvent pas d’un rapport à un objet mais d’un rapport (ou d’un contact, d’une suggestion) entre des moi qui s’appréhendent comme semblables. Il y a une mêmeté des moi (une mêmeté des soi-même) qui rend possible l’identification.
On peut ici ajouter à Freud une remarque sur le double sens du mot « identification ». Outre une assimilation à un autre il peut aussi signifier la constitution et le repérage d’une identité propre. Faudrait-il penser qu’un moi ne se détache et ne se distingue que pour autant qu’il s’assimile à un autre ? Tout l’enjeu est là.
4
Or il se trouve que le ça présente des caractères qui peuvent orienter la réponse.
Le ça emprunté à Groddeck provient lui-même duSelbst de Nietzsche.[6]Celui-ci n’est pas un « soi » (sich) mais un « même » rapporté à lui-même, ce qui est différent puisque « soi » ne contient pas l’idée du même. Or ce Selbst serait doté, selon une note posthume de Freud, d’une Selsbstwahrnehmung, d’une perception de lui-même certes obscure mais par où la mêmeté se perçoit comme telle.
En d’autres termes, on peut dire que le ça se qualifie lui-même comme lieu d’identités possibles, c’est-à-dire de distinctions entre même et même – puisqu’il comporte lui-même la dimension du Selbst. En d’autres termes, le pré-individuel n’est pas simplement ni uniformément le même pour tous : il y a en lui, comme sa structure même, la capacité de donner naissance à des moi qui ne s’individualisent qu’en entraînant dans leur individualité quelque chose de la mêmeté d’où ils sont issus. Et ce quelque chose consiste dans la possibilité du rapport au même. Ou encore : pour devenir moi-même je passe par la perception de l’autre même. J’emploie ici le mot « perception » en pensant à ce que Freud nomme « perceptions internes »[7]. Elles concernent les « couches les plus variées et à coup sûr les plus profondes de l’appareil psychique ». Le meilleur modèle en est le couple plaisir-déplaisir. La variété évoquée renvoie à la variété des modalités ou des qualités qui peuvent être mises en jeu (comment il peut y avoir plaisir ou déplaisir, acceptation ou refus, accueil ou destruction). La profondeur renvoie au ça ou à l’inconscient.
Lorsque dans Massenpsychologie VIII Feud trace un schéma des moi qui ont « mis un seul et même objet [il s’agit du « guide »] à la place de leur idéal du moi et par là se sont mutuellement identifiés dans leur moi » il affirme que c’est « une masse primaire ».
La constitution première de la masse implique une communication préalable entre ceux qui la forment. Cette communication ne peut pas se limiter au rapport à des objets, c’est-à-dire à la libido. Elle doit avoir lieu entre des sujets – non comme un accord passé entre des sujets formés mais en même temps qu’ils se forment. C’est au fond ce que Rousseau pressentait en disant que le contrat social était en même temps l’accession à l’humanité. Or la difficulté bien connue qu’on soulève en demandant comment des non-humains peuvent passer un contrat – acte symbolique s’il en est – se retrouve chez Freud comme la difficulté à démêler la simultanéité et l’antériorité entre les individus et le groupe. Telle est la difficulté rencontrée avec l’identification, difficulté dont Freud convient qu’il ne parvient pas vraiment à la résoudre.
5
Il est exclu de prétendre trouver une solution à ce qui sans doute n‘en comporte pas – s’il ne s’agit de rien de moins que la raison d’être de l’humanité en tant qu’espèce de l’« animal politique ». L’expression d’Aristote ne signifie pas seulement « espèce propre à vivre en cité » mais d’abord « espèce dont la propriété est de s’assembler en discutant et en décidant des modes de son assemblement ». Ce qui chez Aristote se dit « espèce douée de logos ».
Lelangage joue en effet un rôle remarquable chez Freud à propos de la formation du groupe. Dans le supplément B de Massenpsychologie le meurtre du père de la horde primitive est présenté comme le récit fictif qu’un des enfants raconte aux autres. Cet enfant aurait été le dernier-né et comme tel le préféré de la mère qui l’aurait protégé du père. Ce privilégié n’en ressent pas moins la privation du père et se détache de la masse (une masse déjà effective mais mal constituée)[8]. Ce qu’il éprouve est une nostalgie pour le père originel.
Disons-le ainsi : l’ inventeur du premier récit de l’origine veut s’inventer lui-même comme meurtrier du père, c’est-à-dire comme celui qui le remplace. Il le fait sous la pression d’une nostalgie, d’une Sehnsucht qui est aussi, en tant que Sucht, de l’ordre de l’addiction ou de la passion – de ce désir passionné que Freud discerne dans la masse[9]. Il est donc mû par un double affect : cette nostalgie passionnée et la tendresse toute particulière de sa mère. Il en vient ainsi à présenter une « réinterprétation mensongère du temps originaire ». Il forge un mythe dont il est le héros. En récitant aux autres le poème de son invention de l’origine il leur permet de s’identifier à lui car ils éprouvent tous la nostalgie du père. « Le mythe est ainsi le pas grâce auquel l’individu sort de la psychologie de masse ».
Il en sort pour lui donner sa vérité pourrait-on dire. Car le mythe instaure la possibilité même de l’identification. La masse s’identifie au héros et ce faisant s’identifie elle-même comme ensemble d’identités semblables et donc permutables ou substituables. Freud renvoie ici en note à un livre de Hanns Sachs[10]. A lire ce dernier, on voit en effet que Freud lui doit beaucoup pour l’analyse de l’héroïsation. Toutefois il néglige une phrase. Hanns Sachs termine sa description du poète comme héros du conte en faisant observer que son identification (au sens de la reconnaissance) risque d’empêcher ses auditeurs de s’identifier au héros. « Pour écarter cet obstacle le poète doit créer un héros impersonnel ou, pour le dire mieux, surpersonnel avec lequel il peut s’identifier aussi bien que tous les auditeurs puisqu’il est en même temps chacun et aucun. »
Freud néglige cette phrase car son attention reste fixée à la figure d’un héros dominant, devenant Dieu ou Chef. L’identification pour lui est d’abord sinon essentiellement hiérarchique[11]. Il lui soumet l’identifiation horizontale pourtant nécessaire à la première – ce qui ne veut pas dire antérieure mais au moins concomitante. La nostalgie du père le travaille lui aussi alors même qu’il cherche comment les moi en train de se faire – de se séparer du ça et entre eux – s’éprouvent aussi mutuellement comme semblables.
6
Sans doute faut-il revenir de manière plus attentive aux conditions indiquées par Freud lui-même pour le déclenchement du processus d’identification. Il y en a deux : le langage et les affects. Prenons-les l’une après l’autre avant de nous demander quel rapport il y aurait entre eux.
Le langage fait de toute évidence non seulement le moyen mais le lieu effectif de l’identification, qu’il s’agisse de celle du fils au père ou de celle de ses frères au héros qu’il a créé. Il faut bien parler ici de création puisque c’est avec rien que le père est inventé, c’est-à-dire nommé. Sa nomination est à la fois celle de son nom propre – ne fût-il que celui de « Père » comme nom de qui n’a pas plus de nom que d’existence – et celle de la genèse ou génération d’où provient le groupe. Ce dernier s’identifie à une identité inidentifiable. La masse ou le collectif est cela qui se cherche ou qui se projette une identité. Ce qui est en attente ou en demande d’identité, c’est-à-dire de Selbst de soi-même parce que le soi-même est ce qui se perçoit obscurément, confusément comme inhérent à l’existence de quoi que ce soit – de tous les corps physiques ou physiologiques, de toutes les présences entassées ou mêlées.
A cette demande, le langage n‘apporte pas une réponse : il l’expose en tant que demande. Il expose la quête générale de l’identique à travers la multiplicité indéfinie et indistincte. Il est langage en tant qu’il porte la possibilité d’identifier ce qu’on appelle un sens. Ce qu’on peut aussitôt retourner pour dire : en tant que le sens est l’élément de l’identité et de la distinction qui est son corollaire.
Ce au bord de quoi Freud se tient en proposant un mythe de la naissance du mythe c’est très exactement la naissance du langage et/ou du sens. Lacan a très bien perçu que c’était l’enjeu : il qualifie l’identification d’ »identification de signifiant »[12]Il précise aussitôt qu’elle n’est pas « identification imaginaire » ce qu’on peut comprendre ainsi : elle n’est pas identification à une forme ou à une figure donnée mais identification mutuelle de deux (ou plus) qui se découvrent comme « même » précisément en ceci qu’ils peuvent former une forme non donnée, autrement dit signifier.
C’est même là sans doute qu’on saisit au mieux que le « signifiant » de Lacan doit être compris au sens actif du sujet en train de signifier – ou de faire naître du sens (un sujet n’étant en somme rien d’autre que cette capacité ou cette ponctualité signifiante). Elle est la même chez tous et comme elle n’est effective qu’au coup par coup, si on peut dire, en chaque point de naissance de sens, c’est elle aussi qui fait que selon Lacan « le sujet pur parlant […] est amené […] à vous prendre toujours pour un autre ». Et ce rapport à un autre en tant qu’il opère entre tous les mêmes est ce que Lacan traduit comme « grand Autre » mais dont on peut dire aussi bien qu’il est le rapport de sens, lequel est aussi chaque fois rapport au sens comme à ce qui distingue et relie en même temps des soi-même (des moi, donc, mais des moi en train de s’identifier et jamais identifiés au sens d’un participe passé°).
L’interprétation lacanienne satisfait pleinement à la requête de Freud : elle éclaire la communication des moi dans leur stricte distinction et en tant que, issus d’un même ça, ils lui appartiennent encore tout en se séparant comme les mêmes qui se signifient leur commune discrétion – au sens mathématique du mot mais aussi au sens de la réserve, de la retenue de chacun qui reste l’autre et ainsi un tout-autre selon l’expression de Derrida.[13]
7
Cette logique des unités discrètes correspond aussi[14]à ce que Lacan nomme le « trait unaire » : chacun comptant pour un sans qu’aucun vaille pour tous. Il faut donc se demander comment comprendre la distinction – pour le coup pas très discrète – du fils préféré créateur et héros du mythe.
En tant que tel, il est poète et Freud souligne le caractère poétique de cette première parole. On comprend peut-être alors mieux qu’il n’ait pas tenu compte de la dernière phrase de Hanns Sachs : même si le héros doit valoir comme tous et aucun, il a fallu inventer ce personnage « impersonnel ou plutôt surpersonnel ». Peut-être Freud perçoit-il le surmoi que l’inventeur du mythe peut engendrer ou devenir lui-même. A ce titre il faudrait compliquer la question de l’ »archéphilie » évoquée plus haut. L’anarchie dont j’ai parlé ne se sépare peut-être pas sans reste d’une hiérarchie (comme on sait il y a là un nœud problématique pour la démocratie). Mais ce n’est pas à cela qu’il faut s’arrêter ici. C’est d’abord le poète en tant que tel qui est distingué[15]. Or le poète, comme on sait, se distingue pour Freud par une capacité bien particulière. Elle apparaît ici, on l’a vu, dans la « réinterprétation mensongère » qui suppose un talent ou un art d’autant plus spécial que ce qui est « réinterprété »[16]n’avait jamais auparavant été interprété (ou bien il faudrait attribuer au père la qualité d’inventeur du mythe). Le premier poète invente un sens en dissimulant le sens antérieur – ce qui suppose qu’il y en avait un.
Pour ce faire, les poètes jouissent de facultés particulières. C’est ainsi qu’ils disposent « d’une sensibilité capable de percevoir les émotions cachées de l’âme d’autrui et du courage de laisser s’exprimer leur propre inconscient »[17]Le créateur du mythe a perçu la nostalgie du père commune à tous et en faisant parler son inconscient c’est à celui de tous qu’il a donné la parole, une parole ainsi d’emblée singulière et plurielle, communication de tous avec tous en tant que partage du commun. Cette parole n’est pas le logos, du moins pas celui qu’évoque Aristote en tant que faculté « politique » de l’échange au sujet du bien commun. Ou bien il faudrait conjoindre à ce logos, d’une conjonction inextricable, le mythos dont la valeur première est celle non du discours mais de l’expression, de la profération. Si le logos discute, le mythos, lui, prononce. Il est un dire investi dans son propre ditou bien encore il est un dire qui avant tout se dit. On pourrait aller jusqu’à le désigner comme un soi-disant dire.
8
En soi disant il communique aux autres cette soi-disance. Le mythe est une parole propre à tous et à chacun tandis que le logos est un discours pour tous qui n’est propre à personne. C’est ainsi qu’ils sont adossés l’un à l’autre, Janus bifronsdu langage qui puise dans le ça et articule par les moi.
Le poète est donc l’autre du logicien (savant, philosophe, orateur). Il en est l’autre qui parle de la même chose, à savoir justement l’être-ensemble, le Mitsein à quoi tient le langage qui lui-même tient au Mitsein. Si toutefois il se trouve une division interne du langage lui-même, à quoi tient-elle ? De toute évidence le logos est du côté du moi détaché tandis que le mythosrelève du ça en train de laisser un moi se détacher. Aussi la proximité de la poésie avec la psychanalyse est-elle presque une intimité. Une intimité n’est pourtant pas une identité, tout comme une identification n’est pas une unification.
Lacan le sait très bien, qui ne s’est pas contenté de noter la même proximité que Freud mais qui est allé jusqu’à s’identifier lui-même – ou plutôt sa parole, ou lui-même en tant que parlant – comme poème[18]. En disant « je suis né poème et papouète » il s’identifie comme parole originaire, c’est-à-dire aussi originante, en même temps qu’il repousse ce que Bataille nommait la tentation gluante de la poésie et qui depuis ce temps – ou depuis Rimbaud peut-être – n’a pas cessé d’être dénoncé : la poésie comme esthétisme précieux et[19]ronflant.[20]Ce pas franchi semble conduire à identifier psychanalyse et poésie. Mais Lacan ne le franchit que par jeu. Il sait que cela ne peut pas relever d’une décision personnelle car il faudrait que d’abord la mère et le groupe l’aient déclenché.
Comme on l’a vu, ce déclenchement demande certaines conditions. Celles-ci ne sont pas forcément absentes aujourd’hui et il y a des poètes – en tout cas des poèmes – parmi nous même s’il n’y a pas les conditions d’un Homère ou d’un Shakespeare, pour prendre deux moi douteux et porteurs d’une irrécusable puissance d’identification dont les effets ne sont pas éteints.
On peut donc dire « poésie et psychanalyse remettent en question le Savoir pour, dans leur pratique, ouvrir à la vérité. »[21]A quoi il faut ajouter que c’est très exactement à ce geste que la philosophie s’est essayée ou confrontée depuis Hegel jusqu’à nous, que Lacan a su reprendre et que Freud entamait en affirmant que les pulsions sont « nos mythes ». Il n’en reste pas moins qu’on doit se demander pourquoi il y a trois prétendantes à un rôle qui semble bien exiger l’unicité.
9
L’unicité – voire l’isolement – du fils cadet est en effet nécessaire pour permettre que le mythe s’adresse à chacun et à tous en même temps. Il faut qu’une même voix frappe les oreilles de tous les semblables. (Le fascisme, qu’il soit national-racial ou tec’hno-mondial, n’est pas autre chose que la prodction artificielle et forcée dune voix unique.)
Or ce qui isole le cadet, ce qui le pré-individualise pourrait-on dire, c’est d’abord d’être le dernier-né, qui clôt la série, et c’est ensuite d’être préféré par la mère. Celle-ci le préfère sans doute justement parce qu’il met fin à la série. Tout se passe comme si la fécondité du père ou celle de la mère était terminée ou comme si la mère, en tout cas, voulait y mettre fin (et donc comme si en un sens le rôle du père avait déjà commencé à pâlir). Le cadet est ainsi l’objet ou le sujet de deux affects puissants : l’amour de la mère, la haine du père.
Ce double affect est l’affection même dans son ambivalence. L’affection ne survient pas seulement du dehors au sujet : elle le façonne et elle est ce par quoi il façonne le monde (le colore, le fait vibrer). L’amour de la mère est cela même : la mise au monde. Pour cette raison, la mère n’est jamais complètement distincte du monde (ou du ça) et pour la même raison elle peut être rejetée autant qu’aimée car être au monde signifie aussi ne plus être le monde lui-même en son identité indistincte.
. Le père en revanche est le détachement même : il est la possibilité d’un hors-monde, d’une autonomie. Il est donc haï de deux manières : comme une éjection[22]au dehors bien distincte d’une mise au monde, mais en même temps comme la position auto-suffisante qui ne peut que faire l’ »idéal du moi » dès lors qu’un moi se détache ou tend à se détacher.
Cette double duplicité affective, ce doublement entre mère et père de l’ambivalence qui est au fond l’affect même – la poussée repoussante vers le détachement, vers l’individualité – oblige à s’écarter un peu de Freud ou à le prolonger pour reconnaître que c’est un même mouvement : celui du ça. L’obscure perception de soi du ça ne peut que percevoir tout à la fois une forme de mêmeté à soi et la poussée ou la pulsion de cette forme vers elle-même c’est-à-dire vers son détachement en tant que « moi ».
Le ça et le moi s’entr’appartiennent de telle sorte que non seulement le moi est tendu vers son détachement mais cette tension est aussi bien celle du ça. Moyennant quoi le ça ne peut que continuer à relever du ça et le ça ne peut que continuer à être au fond du moi. Mais alors il faut comprendre la nostalgie du père comme un génitif objectif et subjectif : nostalgie pour le père etnostalgie paternelle pour le moi dans lequel il veut se retrouver. On peut le dire en termes de narcissisme : le narcissisme absolu étant exclu (contradictoire dans ses termes) il faut se confier au narcissisme relatif – c’est-à-dire à l’œuvre dans la relation ou bien lui-même relationnel.
En allant plus loin on montrerait commnte père et mère sont intriqués l’un en l’autre ou comment être-jeté et être-au-monde sont corrélés mais aussi comment cette corrélation implique le collectif ou la pluralité des moi puisque du côté du père il ne peut y avoir qu’exclusion de l’unicité et du côté de la mère il y a le monde, lequel implique l’altérité et la circulation des discrètes unités de sens. Et des deux côtés ambivalence affective : amour et haine de ce qui m’a pro-jeté et de ce qui m’a ouvert le monde.
10
L’affectivité, comme on l’a dit, ne survient pas au sujet : elle l’émeut et ainsi le meut. Comme l’écrit Simondon : « L’affectivité-émotivité est un mouvement entre l’indéterminé naturel et le hic et nunc de l’existence actuelle. »[23]- existence qui se trouve ainsi « incorporée dans le collectif » car « l’individu en tant qu’éprouvant est un être relié ».
A ce point, on ne peut plus douter de ce que Lacan affirme ainsi : « Le collectif n’est rien que le sujet de l’individuel. »[24]Ce qui bien entendu doit être compris selon le caractère du sujet lacanien dont « l’existence est celle d’un «’entre’, il appartient à une mésologie[25] ». Le collectif est à la fois le milieu si on peut dire naturel de l’individu et l’écart relationnel par lequel les individus s’y rapportent les uns aux autres. Ils s’éprouvent mutuellement en tant qu’ils s’émeuvent : si légère que soit l’émotion c’est elle qui remue les moi entre eux.
Qu’en est-il du langage dans ce remuement ? Freud n’en dit rien – bien qu’il prenne soin de signaler la « calotte acoustique » du moi[26] Pour Lacan, le langage fait de l’affect « autre chose ». « Il en fait, par la parole, un moyen de communication. »[27]. Pourtant, si l’affect a déjà lieu dans le rapport à l’autre, il est difficile d’en rester à ce déplacement – qui pour Lacan est celui de la métaphore en tant justement que déplacement (c’est le sens grec du mot) du propre en figuré ou du fantasme inexprimable en parole communicable.[28]
Si on en restait là on n’aurait rien dit des raisons de cette supposée métaphorisation. Il faut aller plus loin dans le rapport du langage à l’affect. Rousseau nous ouvre la voie. On sait qu’il écrit « les besoins dictèrent les premiers gestes, les passions arrachèrent les premières voix »[29]. L’affect fait parler ou plus exactement il fait d’abord résonner la voix[30]. Celle-ci n’est pas d’emblée le langage articulé mais l’élément sonore de ce que Bernard Baas nomme « la voix en corps » : la voix en tant qu’elle vient du corps, qu’elle est de lui et se forme en lui.
Ce qui se forme ainsi porte le corps hors du corps. Cela le fait entendre. Cet entendre est un sentir : la voix module pour Rousseau « les accens[31]de la passion » et « ces accens nous font tressaillir […] nous font sentir ce que nous entendons ». Dans la voix le corps se communique au corps de l’autre. Cette communication ignore toute transposition d’un inexprimable en une expression : elle fait rapport, elle est simultanément découverte de l’autre – de soi comme autre, de l’autre comme soi, le même/la même– et appel à l’autre[32]. La primauté du collectif sur l’individuel tient à ce que l’appel à « toi » est contemporain du détachement du « moi ».
Cet appel ne communique une émotion que parce que l’émotion elle-même est appel du dehors et au dehors – mise en branle du même comme tel. Nulle part, en même temps, ne se marque mieux le caractère de l’identification en tant qu’elle n’est ni fusion, ni unification. L’émotion ne ramène pas au ça, elle est bien plutôt l’autoperception du ça en tant que s’appelant.
Ça s’appelle, et dès que ça s’appelle ça s’altère et ça s’identifie.
11
C’est en quoi c’est poétique. Le poème n’est pas d’abord une mise en jeu de la langue sur les bords extrêmes de la signification. Il est bien plutôt l’ouverture de la possibilité du sens. Jean-Christophe Bailly écrit :
« c’est ici […] que se cache – et que surgit la nature sonore du poème et son rapport natif à la prosodie et au chant : le poème n’invente rien, mais se portant ainsi au devant du langage, il en recueille pleinement la résonance, et confond cette résonance à l’intensité d’un sens. Le poème est la tonalité du sens »[33]
A quoi il suffit d’ajouter que le sens est avant tout tonalité – tension, vibration, inflexion non pas simplement de la voix comme phénomène acoustique mais de la voix en tant que corps ému. Le sens, c’est qu’il y ait de l’appel et de la réponse. Ce n’est pas la signification, qui d’elle-même renvoie indéfiniment à d’autres significations. C’est au contraire ce renvoi lui-même en tant qu’envoi à l’autre.
Le sens n’est pas au-delà de la signification : il est la signifiance de toute signification en tant qu’elle est toujours encore à venir. Et en corps pour reprendre l’homophonie que Baas fait résonner. Le sens vient par l’autre et comme l’autre, il vient comme l’auto-altération du ça. Auto-altération en effet – coordonnée à l’auto-perception – puisque la voix s’entend. Du Narcisse parle de Valéry Derrida tire ceci : « la voix semble se passer du détour de l’extériorité du miroir ou de l’eau, du monde, pour se réfléchir immédiatement elle-même, dans l’intime instantanéité de la résonance. »[34]
C’est ainsi que le poème, tout autant qu’il fait résonner sa voix en elle-même, sans intention communicative, fait résonner non seulement des émotions mais la motion ou la pulsation du monde. « Le plus ancien poème est la religion » écrit Kant[35]. La religion ici n’est pas une croyance, elle est l’appel et l’écoute d’une voix qui est celle de tous à travers un corps – un corps totémique, un corps mythique qui n’en est pas moins en même temps celui d’une voix singulière. C’est le récit du mythe de la tribu.[36]
Certes, il arrive qu’un groupe ne trouve pas ou bien perde son mythe. Alors il commence à se décomposer, ses poètes ne le sont que de nom, pour faire des effets, et le monde se change en connexion. Mais lorsqu’elle a lieu, la poésie (non la pouasie) donne une voix non seulement à tous[37]mais au cosmos – qui lui aussi est dans le ça. La nostalgie du père selon son double génitif est nostalgie du sujet pour un monde et du monde pour ceux qui le peuplent. La poésie est la voix mise au monde et le monde mis en voix.
Ce qui peut se dire par ces vers de Michel Deguy où l’ « identification » a le sens d’une assimilation identitaire et se voit opposer la similitudes des mêmes :
La comparaison entretient l’incomparable
La distinction des choses entre elles
Poésie interdit l’identification
Pour la douceur du comme rigoureuse
Commun ?
Comme-un
C’est tout comme si
C’était comme-un.
[38]
Note:
Le moi et le ça III. – Je me contenterai d’indiquer les sections dans les textes de Freud car je préfère les traduire moi-même et cette référence permettra de se repérer aussi bien à ceux qui veulent voir l’allemand qu’à ceux qui veulent consulter les traductions. Aussi bien ne s’agit-il pas d’un travail d’érudition.
Ou par un supplément au sens analysé par Derrida.
Avec Philippe Lacoue-Labarthe j’avais travaillé ce point dans La Panique politiqueen 1979 (republication chez Christian Bourgois en 2013).
Ce mot, en 1921, n’est pas chargé des valeurs qu’il a aujourd’hui – tantôt péjoratives et tantôt révolutionnaires. Il désigne à la fois le nombre, la multitude, le collectif ou le commun découvert depuis environ un demi-siècle comme agrégation, assemblement ou mêlée d’individus – c’est-à-dire comme ce qui fait problème dès lors qu’on part de l’individu ce qui est le cas de Freud comme de tous, à l’exception des marxistes pour qui le concept de classe est censé transformer toute cette problématique. – Le pluriel du mot dans le titre de Freud correspond à celui des « foules » dans le livre de Le Bon qu’il commente. Comme ce terme a aujourd’hui une connotation plus dispersive qu’en 1900 (« il y a foule dans le métro ») je préfère garder le mot « masse ».
Lors de son voyage aux Etats-Unis en 1909 Freud déclarait qu’il voulait observer un porc-épic sauvage…
J’ai analysé cela dans Cruor.
Le moi et le ça, 2.
Comme Freud l’explique de manière complexe et un peu maladroite car il semble vouloir à la fois parler de l’origine et retracer un premier parcours préhistorique qui aurait conduit d’une première société totémique, renonçant à l’héritage du père, à une »nouvelle famille » aux pères multiples et dépourvus de la toute-puissance du père originel et de ce fait insatisfaisante (qui semble correspondre à une société contemporaine des tout premiers mythes connus et de la poésie dont Freud veut parler). De ce fait, sa scène est à la fois première et seconde – ce qui est très instructif quant à l’impossibilité de saisir une origine au sens propre.
Massenpsychologie II.
Gemeinsame Tagtraüme(Rêves éveillés en commun).
Ou bien « archéophilique » comme nous disions dans La Panique politique
Séminaire de 1961-1962 sur l’identification, séance du 22 novembre 1962.
« Tout autre est tout-autre »
Dans le même séminaire.
Bien entendu, on devrait poser la question d’un pouvoir du poète. Mais je ne peux le faire ici.
Umdeutung peut être compris avec la valeur d’un retournement,d’une inversion voire d’une perversion.
Beiträge zur Psycholgie des Liebeslebens, I (Contributions à la psychologie de la vie amoureuse). Comme on sait, Freud est souvent revenu sur les facultés suoérieures des poètes et des artistes en général en matière de pénétration de la psychè. On lit dans L’Avenir d’une illusion II que « Les œuvres de l’art exaltent les sentients d’identification dont chaque groupe culturel a si grand besoin. »
Œuvres graphiques et manuscrites p. 48.
Esther Tellermann, Freud-Lacan« Consultation-document (Freud-lacan.com)
Ce refus moderne de la « poésie-pouasie » constitue un symptôme majeur de la disparition du mythe et de la nostalgie qui l’accompagne depuis le romantisme allemand. La nostalgie a substitué le mythe au père et cette nostalgie aggravée souffre de ne pas pouvoir faire naître un nouveau dire originel.
Esther TELLERMANN S’apparenter à un poète.pdf (gnipl.fr), Le terme « apparenter » est repris de Lacan et se distingue bien sûr de la «plate parenté » : c’est ce que ce texte commente.
Il faut bien sûr penser à la Geworfenheit – l’être-jeté chez Heidegger.-
L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Million, 2003, p. 247 puis 244 Il faudrait, ailleurs, suivre de près ces analyses de Simondon, notamment dans leur rapport distancié avec la psychanalyse..
Ecrits, Seuil, 1966, p 247. Cette phrase vient à la suite d’un rappel de Massenpsychologie.
Etude des milieux, donc des relations, rapports et échanges.
Le moi et le ça, 2. La calotte figure dans le fameux dessin de la deuxième topique. Paul Celan a repris et décalé la Hörkappe en Hörklappe(clapet acoustique) dans son poème Schief. Voir le commentaire par Jean Bollack : « Celan lit Freud », dans Savoirs et clinique, 2005/1 n°6. Cette intervention du poète mériterait encore d’autres commentaires : pour rester bref je dirais qu’il semble signifier qu’il entend autrement ou mieux que l’analyste.
Séminaire sur l’identification, mai 1962.
La pensée de Lacan ne se réduit pas à cette vulgate lacanienne. On peut se reporter par exemple à « L’erre de la métaphore » de Eric Porge, Essaim n°21, 2008. Voir du même Voix de l’écho, Erès, 2012. Ce qui déplace l’opposition du propre et du figuré dont procède l’idée même de métaphore demanderait bien sûr de passer par « la Mythologie blanche » de Derrida et la discussion avec Ricoeur qui a suivi ce texte. Parallèlement à ce travail philosophique c’est vers une topologie que s’est dirigé Lacan. Pour ma part, je voudrais revenir vers la poésie, c’est-à-dire montrer que s’il doit s’agir du poème il faut bien alors excéder tout discours de savoir. Non pour dire plus ou mieux, mais pour s’en remettre au dire.
Essai sur l’origine des langues.
Au sujet de la voix entre psychanalyse et philosophie il faut lire les travaux de Bernard Baas, La voix déliée, L’écho de l’immémorialet – à paraître – Jouissances de la voix (où il parle de « la voix en corps »
Orthographe d’époque.
O doit penser à la « pulsion invoquante » introduite par Alain Didier-Weil et reprise par Lacan
Naissance de la phrase, Nous, 2020, p. 61.
Marges de la philosophie, Minuit, 1972 p. 341. Certes il faut préciser que cette « immédiateté » est une apparence (« semble » écrit Derrda). La voix s’articule et donc se médiatise. Il n’y a pas de distinction tranchée entre voix et discours, entre sens et signification. Chacune et chacun renvoie plutôt à l’autre, résonne dans l’autre (ce qui fait un « sujet ») A propos de la résonance on trouve un écho dans mon A l’écoute (Galilée, 2002)
La religion dans les limites de la simple raison, I, 1
Comment on passe de la voix totémique à la croyance, et comment dans la phrase de Kant il s’agit, pour tout citer, de « la religion des prêtres », c’est une question que je ne peux pas aborder ici.
Même à ceux qui ne l’entendent pas. Aussi longtemps que le mythe se prononce, il touche tous les membres du groupe, il fait identification. Lorsqu’il cesse de le faire et que « le mythe » devient une propagande, que ce soit celle d’un dictateur ou celle d’une bande de publicitaires (c’est la même chose) le groupe tout entier entend mais ce qui en fait n’est pas sa voix. Ou bien il cesse par là même de faire groupe et fait plutôt masse au sens actuel du mot Bernard Baas examine ce point au chapitre « Des clameurs du peuple » de Jouissances de la voix.
Aide-mémoire dans Comme ci Come ça, Gallimard, 2012, p. 105(texte paru en 1985).